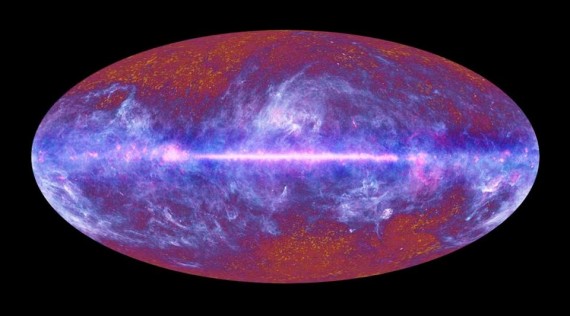«C'est
un pas de géant dans la compréhension des
origines de l'Univers» qui serait né il
y a 13,82 milliards d'années, avec une
connaissance vingt fois meilleure qu'auparavant, s'est
félicité le directeur
général de l'Agence spatiale
européenne (ESA), Jean-Jacques Dordain, en
présentant les premiers résultats de Planck
à Paris.
«Les
données de Planck corroborent de façon
spectaculaire l'hypothèse d'un modèle d'Univers
relativement simple», plat et en expansion, tel que
décrit par la théorie standard du Big Bang,
résume l'ESA.
Certes,
cette carte «ressemble un peu à un vilain ballon
de rugby ou à une oeuvre d'art moderne, mais je peux vous
assurer que certains scientifiques auraient pu échanger
leurs enfants contre cette image», a lancé George
Efstathiou, astrophysicien à l'Université
britannique de Cambridge (Royaume-Uni), qui commentait les
résultats de Planck au siège de l'ESA.
Car
«il s'agit d'une image de l'Univers tel qu'il
était 380 000 ans après le Big Bang»
seulement, lorsque sa température frisait les
3000°C, a-t-il souligné.
Avant
cela, l'Univers était si chaud qu'aucune lumière
ne pouvait s'en échapper. Planck a donc capturé,
sur l'intégralité du ciel, la trace fossile des
tout premiers photons (grains de lumière) qui ont jailli
dans le cosmos, voyageant pendant plus de 13 milliards
d'années pour nous parvenir.
Ce
rayonnement fossile est désormais ultra froid, à
seulement 3°C au dessus du «zéro
absolu» (-273°C). Invisible à nos yeux, il
peut toutefois être détecté dans la
gamme des ondes radio.
Grumeaux
Le
rayonnement de fond cosmologique (CMB) présente d'infimes
fluctuations de température qui correspondent à
des régions de densité
légèrement différente, des
«grumeaux» de matière qui portent en eux
le germe de toutes les étoiles et galaxies que nous
connaissons aujourd'hui.
Mais
pour pouvoir mesurer ces infimes fluctuations, au
millionième de degré près,
l'instrument haute-fréquence HFI de Planck a dû
être refroidi à seulement un dixième de
degré au-dessus du zéro absolu.
Une
prouesse technologique, en apesanteur et dans le vide, «sans
équivalent» et qu'«aucun engin spatial
ne pourra surpasser avant longtemps», a relevé
Jean-Jacques Dordain.
Globalement,
cette première vague de données (500 milliards de
mesures combinées) confirme «de façon
éclatante et avec une précision
inégalée le modèle cosmologique
standard», fournissant du même coup une
connaissance plus fine des ingrédients de la
«recette cosmique».
Selon
le CNRS et l'agence spatiale française (CNES), qui ont
financé plus de 50% de la fabrication de Planck, la
quantité de «matière
ordinaire», celle que nous connaissons au quotidien, a ainsi
pu être légèrement
réévaluée à la hausse.
Elle
ne représente toutefois que 4,9% de la masse totale de
l'Univers. La matière noire, dont l'existence n'a
été mise en évidence qu'indirectement,
en constitue 26,8%. Le reste (68,3% contre 72,8% auparavant)
consisterait en une mystérieuse
«énergie noire», qui serait à
l'origine de l'accélération de l'expansion de
l'Univers.
Planck
a d'ailleurs permis de réviser à la baisse le
rythme de cette expansion par rapport à la valeur de
référence utilisée actuellement par
les astronomes. «Il en résulte que l'âge
de l'Univers serait de 13,82 milliards d'années»,
soit 80 millions de plus que ce que l'on pensait
précédemment, souligne l'ESA.
La
carte de Planck est si précise qu'elle a fourni quelques
résultats surprenants, notamment sur les échelles
les plus grandes de l'Univers.
«Il
y a une partie de l'image où le modèle ne
décrit pas exactement ce qu'on attendait (...) C'est
peut-être un signe que le modèle de l'inflation de
l'Univers est incomplet», selon François Bouchet,
l'un des responsables de la mission pour le CNRS.
Une autre physique, plus
«exotique», serait-elle nécessaire pour
le décrire en entier? Voilà de quoi donner du
grain à moudre aux scientifiques du monde entier durant des
années, espère Jean-Jacques Dordain.